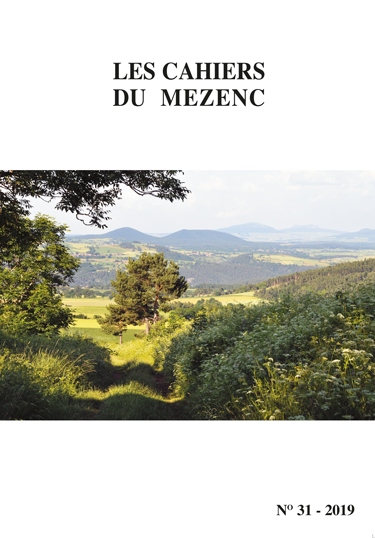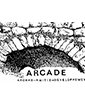Les Cahiers du Mézenc N°31
2019
AVANT-PROPOS
Emmanuelle Defive jardine depuis longtemps les cailloux. Elle nous invite à poursuivre la visite de son jardin géologique qu’elle ne voudrait pas secret et où les sucs l’emportent sur les serres. Un jardin de phonolites minéral et potentiellement musical. Après avoir dégagé l’année dernière, dans le Cahier du Mézenc n° 30, les principes généraux de la valorisation géopatrimoniale et évoqué la richesse de la commune de Borée en ce domaine, l’auteure propose un deuxième volet consacré au Cirque des Boutières, aux Sucs de Sara et de Chabrières et au Rocher des Pradoux. Chaque édifice volcanique est décrit dans sa structure et sa genèse, daté, étudié selon la composition chimique et le degré de cristallisation des minéraux qui composent ses laves et témoignent d’une très grande diversité.
Avec « Quand l’Ours s’éveilla et la Vipère mourut » Jean-Paul Raynal nous propose une allégorie, celle des puissances chtoniennes qui engendrèrent les deux Breysse au réveil du grand Ours, légendaire et gigantesque gardien du pays souterrain des chasseurs morts, tandis que la vipère de lave qui déteste le froid se frayait un passage. Monde des correspondances entre le minéral, l’animal et l’humain néanderthalien. Monde de Néanderthaliens endurcis, observateurs choisis d’un réveil tardif des volcans cévenols. On doit à Hervé Quesnel la langue d’oc de ce conte qui se veut lien racinaire avec les premiers habitants de ce haut pays qui est le nôtre.
L’article paru dans le numéro 30 des Cahiers du Mézenc sous la plume de Jean-Jacques Léogier et Jean-Claude Mermet et intitulé « Quel avenir pour le Mézenc ? » a suscité remarques et réactions verbales ou écrites, telles celle de Jean-Marc Gardès, qui s’associe à la démarche pour un nouveau temps de réflexion avec le souci partagé avec d’autres, au-delà du constat, de rechercher et d’identifier les causes, le jeu de leurs interactions du local au plus global, pour dégager ainsi un espace des possibles pour le massif Mézenc-Gerbier et les « Hommes d’en Haut ».
La chaumière dans laquelle a été installée l’école publique de Vernazon, en 1900, ne devait pas être à l'époque la plus misérable du hameau. Elle avait été choisie sans doute faute de mieux, même si elle ne devait pas présenter toutes les qualités d’hygiène, d’éclairage et de température, bref de confort, auxquelles on aurait pu s’attendre pour y faire la classe à de jeunes enfants. Les conditions de vie et de travail proposées étaient même moins défavorables que celles rencontrées par beaucoup de familles chez qui l’on couchait encore sur la paille, pêle-mêle, avec les bestiaux, comme le rapporte Michel Engles. Et l’auteur de s’interroger sur l’existence d’une ruralité déjà délaissée au moment où l’on édifiait en contexte urbain, à la fin du XIXe siècle, des palais scolaires.
Les habitants d’Arcens, ceux du quartier de la gare en particulier, ont renoncé depuis longtemps à y attendre un train aussi improbable que Godot. Jean Claude Ribeyre raconte pourquoi. L’histoire de ce quartier débute avec la reconstruction en 1890 d’un pont de pierres moyenâgeux qui allait offrir aux habitants d’Arcens et à leur voiture hippomobile, un débouché sur un nouveau chemin d’intérêt commun le long de l’Eysse, partant de Saint-Martin-de-Valamas, et qui allait mettre des décennies pour atteindre Saint-Martial. L’auteur décrit par le menu les péripéties de la construction de locaux industriels, de commerces et d’habitations d’un quartier périphérique à défaut de constituer une banlieue. On vérifiera ce que les urbanistes et les historiens ont mis souvent en évidence : le pouvoir structurant des axes de circulation dans la mise en place d’établissements humains.
À l’aide d’une série de cartes et à partir de l’exemple précis du moulin du Mas à Borée, moulin d’origine médiévale, Colette Véron montre comment la construction d'un moulin hydraulique s'est souvent accompagnée de la mise en valeur de bords des eaux jusque-là considérés comme hostiles. La présence d’un moulin impacte la structuration de l'espace par les aménagements hydrauliques qui l'accompagnent, la création de nouveaux terroirs mais aussi par l'aménagement de voies d'accès à un espace désormais régulièrement fréquenté.
L’établissement d’un nouveau compoix représentait une mobilisation et une dépense très importantes pour une communauté comme celle de Saint-Martial Bonnefoy au terroir de la Combe du Pradal. Rédigé entre 1656 et 1658, ce document, commenté dans cet article par Christian Déal, permet, grâce à son répertoire de reconstituer assez fidèlement les limites géographiques de cette communauté. Ce compoix est un ancêtre du cadastre et évite le recours à de longs procès lors de conflits de limites entre voisins ou entre paroisses. Avant tout, il est un document fiscal qui recense une à une les terres des particuliers en vue de l’assiette du principal impôt direct : la taille. Ce compoix est aujourd’hui consultable sur le site.
Un journal paroissial écrit à plusieurs mains par une succession de prêtres titulaires au XIXe siècle de la cure de Chanéac en hautes Boutières donne à Georges Vignal l’occasion de dresser un tableau des relations entre autorité religieuse et autorité civile où le différend principal semble porter sur l’état de vétusté du presbytère et de l’église face à l’opportunité de désenclaver la communauté locale et de construire un bâtiment scolaire. Autrement dit, privilégier le temporel ou le spirituel, sortir ou non du quant à soi et de la tradition.
Ouvrant un propos consacré à la protection des plantes sauvages des environs du Mézenc, Jean-Paul Rique consacre une première livraison à définir le cadre institutionnel et réglementaire de la protection des végétaux Il existe, en effet, une législation spécifique pour protéger de la disparition les espèces en danger d’extinction. Législation d’autant plus nécessaire que les végétaux sont l’alpha et l’oméga de l’évolution humaine. Ils sont à l’origine de la vie sur les terres émergées de notre planète grâce à la couche d’oxygène qu’ils y ont créée, ils sont également à l’origine de la chaîne alimentaire. Ce sont eux qui ont nourri les premiers animaux herbivores, permettant ensuite l’apparition des prédateurs carnivores primaires et secondaires, bouclant ainsi la chaîne de consommation.
Afin de rendre hommage à Paulette et Marcel Eyraud récemment décédés et avec le concours de Dominique, leur fille, des membres du comité de lecture des Cahiers et d’Amis du Mézenc dépositaires de fonds photographiques anciens, Jean-Jacques Léogier et Jean-Claude Mermet proposent le récit d’une excursion au Mézenc en 1898. Paulette et Marcel habitaient alternativement dans leur maison des Estables et leur appartement du Puy. Ils ont ainsi régulièrement pratiqué les routes qui mènent de l’un à l’autre. Parcourir routes, chemins et sentes réactive la mémoire ; c’est pourquoi les auteurs et le collectif précité vous invite à un parcours imaginaire et cependant bien réel parce que documenté à partir de photos légendées et commentées de la fin du XIXe siècle. Une exposition sur le même thème, visible cet été 2019, sera proposée aux Estables et à Borée.
Cette nouvelle livraison est spécialement dédiée à Paulette Eyraud et Brigitte Riffard qui contribuèrent, chacune à leur manière, à rendre pérenne l’association des Amis du Mézenc et la revue que vous avez aujourd’hui dans les mains. À elles notre reconnaissance.
À tous, bonne lecture !